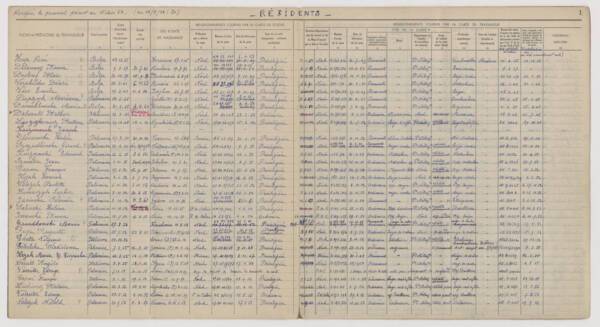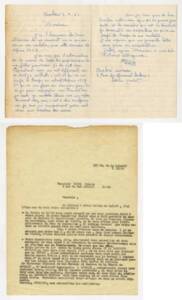En 1927 est adoptée une nouvelle loi sur la nationalité. Elle introduit dans le vocabulaire juridique la notion d’assimilation, définie comme "l’absorption plus complète et parfaite des éléments étrangers dans la nation". L’objectif semble donc, pour les travailleurs immigrés, de faire disparaître tous les signes susceptibles de "trahir" leur origine étrangère. Le projet de se fondre dans la société du pays d’accueil se traduit tout d’abord pas la francisation des noms. Pendant l’entre-deux-guerres, cette question fait d’ailleurs l’objet de violentes polémiques, certains y voyant un impératif administratif tout autant qu’un facteur décisif d’intégration. D’autres redoutent au contraire que des immigrés ne se "cachent" derrière un nom français. Le code de nationalité de 1945 tranche le débat en permettant aux étrangers en instance de naturalisation de franciser leur patronyme par une procédure simplifiée. Mais même avant 1945, le choix est souvent fait par les ouvriers immigrés de donner à leurs enfants des prénoms français. L’assimilation prend également d’autres formes, notamment l’apprentissage d’une langue à la grammaire notoirement complexe.
"Le livre de français posé devant Hamid est destiné aux tout-petits, comme le prouvent les dessins de chiots aux grands yeux, de chatons jouant avec des pelotes de laine, les grosses fleurs s’ouvrant au soleil et les mamans gentilles préparant des gâteaux pour des bambins aux joues roses. C’est l’instituteur qui a sorti pour lui de la bibliothèque ce manuel du cours préparatoire.
Hamid tente de de mettre de côté sa honte (il a onze ans, il aime les chevaliers, les super-héros, les duels à l’épée, les combats à mains nues contre les lions. Il ne croit plus au monde rose et rond des livres pour les petits) et d’attraper le français à bras-le-corps. Ce qu’il appelle "français" et qu’il voit comme un butin qui étincelle et l’attire depuis un mont escarpé ou le fond d’une mer particulièrement infestée de squales, c’est en réalité l’écriture, l’alphabet. Hamid n’a jamais divisé sa langue maternelle en mots, et encore moins en signes – c’est une substance étale et insécable, faite de murmures mêlés de plusieurs générations. Alors cette série de lignes et de ronds, de points et de boucles qui se présente désormais sur la page lui paraît une armée en marche, prête à envahir son cerveau et à faire pénétrer le haut des t, la queue des p dans la matière molle qu’abrite sa boîte crânienne. Pourtant, malgré la peur, malgré la honte, malgré le mal de tête, il y a aussi de la magie dans le lent apprentissage que fait Hamid. Les premières phrases qu’il parvient à déchiffrer, celles qui s’énoncent lentement et dans lesquelles chaque syllabe pèse son poids d’importance, la beauté du son qui écarte les lèvres comme un objet physique trop gros pour sortir de la bouche, ces phrases-là lui resteront toute la vie.
Tata tape le tapis.
Papi fume la pipe".
Extrait de L’Art de perdre d’Alice Zeniter (Paris, Flammarion / Albin Michel, 2017). Ce roman raconte l’histoire d’une famille de harkis ayant fui l’Algérie au début des années 1960 à travers trois personnages appartenant à des générations différentes : Ali, le grand-père qui travaille notamment comme ouvrier dans une usine de transformation de métaux à Messei dans l’Orne ; Hamid le fils, qui suit ses parents dans l’exil ; Naïma, la petite-fille, née en France et qui cherche des décennies plus tard à retracer le parcours de sa famille paternelle. Dans cet extrait qui se situe dans les années 1960, Hamid apprend à lire le français.